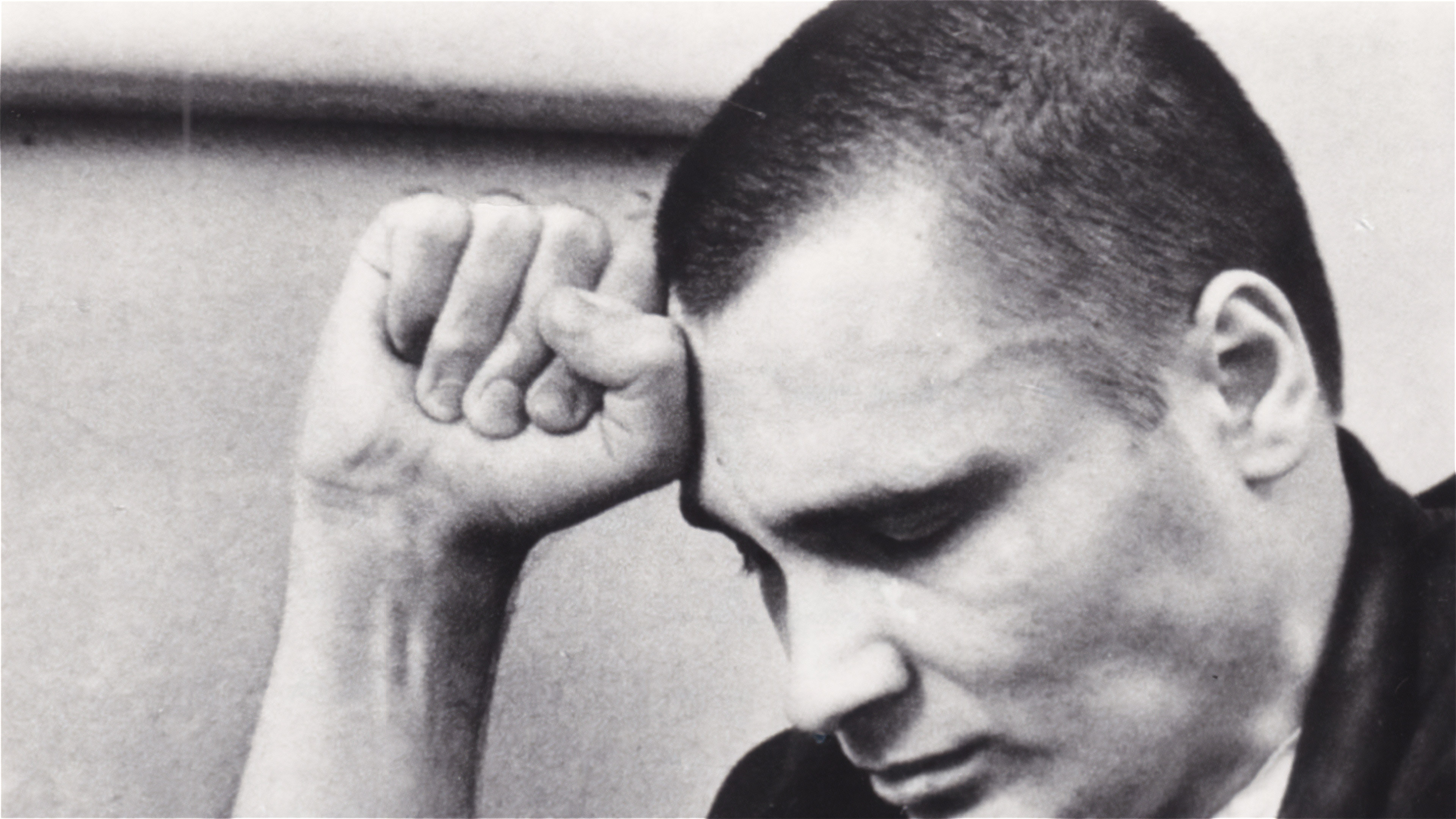Nombreux sont ceux à être partis vivre dans la capitale allemande, prisée pour sa douceur de vivre, ses loyers modérés, sa jeunesse et sa vitalité. Vingt-cinq ans après la chute du Mur, la ville offre un nouveau visage, où se lit pourtant, jusque dans sa géographie, la trace de son histoire singulière qui jalonne un siècle de cinéma....
« Vivre ailleurs en Allemagne ? Impossible ! » Ainsi s’exprime Rudolf Thome, réalisateur allemand né dans un petit village de la Hesse, venu s’installer à Berlin dans les années 1970 : « Ici, tout était possible. On pouvait vivre avec quelques marks en poche. » Depuis, il a quasiment tourné tous ses films à Berlin, notamment Le Coup de foudre (1992), récit d’une histoire d’amour entre deux êtres que tout oppose (allégorie des deux Allemagne, des deux Berlin ?), un archéologue de l’Est et une futurologue de l’Ouest. « Je ne reviendrai probablement jamais parce que c’est à Berlin que je veux vivre », dit le jeune Billy Wilder à ses parents quand il quitte Vienne pour Berlin. « Berlin dans les années 20 était LA ville de l’Europe », sa vie nocturne « démente ». Il la quitte le jour de l’incendie du Reichstag par les nazis, en 1933, mais reviendra filmer ses décombres, après la guerre, pour La Scandaleuse de Berlin (1948). La place à part de Berlin en Allemagne, son lien intrinsèque à l’Histoire, Wim Wenders les souligne aussi, à l’occasion de la sortie des Ailes du désir (1987) : « C’est le désir de quelqu’un longtemps absent d’Allemagne et qui n’a jamais voulu ni pu reconnaître, ailleurs que dans cette ville, ce qui fait qu’on est Allemand. Cependant je ne suis pas Berlinois. Mes visites, depuis vingt ans, sont pour moi les seules expériences allemandes véritables parce que l’Histoire est ici physiquement et émotionnellement présente, une histoire qui ne peut être vécue ailleurs en Allemagne, dans la République fédérale, que comme dénégation ou absence. »